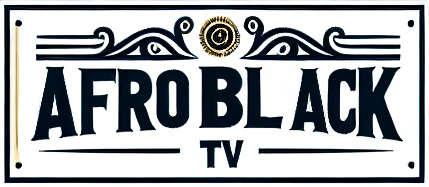Ce que Nollywood ne montre (presque) jamais »
Ce que Nollywood ne montre (presque) jamais »
Introduction
Nollywood, deuxième industrie cinématographique mondiale en volume, est devenue un pilier culturel en Afrique et dans la diaspora. Grâce à son accessibilité, ses récits familiers et son rythme de production effréné, elle a su captiver des millions de spectateurs. Pourtant, derrière cette abondance d’images et de récits, se cache un phénomène plus discret : la sélection très encadrée, parfois autocensurée, des sujets abordés. Entre pressions sociales, économiques et politiques, Nollywood évite souvent de représenter certains thèmes sensibles. Cette tendance soulève une question centrale : quels sont les sujets que Nollywood ne montre presque jamais, et pourquoi ?
I. Une industrie influencée par des normes culturelles et religieuses fortes
-
La domination des valeurs conservatrices
-
La société nigériane, fortement marquée par les valeurs religieuses (chrétiennes et musulmanes), impose des limites implicites à la représentation de certains sujets.
-
La sexualité, l’homosexualité, ou les critiques explicites des religions y sont rarement évoquées, voire totalement absentes.
-
Exemple : les personnages LGBTQ+ sont souvent caricaturés, diabolisés ou invisibles.
-
-
La pression de l’acceptabilité sociale
-
Pour éviter le rejet du public majoritaire ou de la censure officielle, les scénaristes préfèrent contourner certains sujets délicats.
-
L’image de la femme, bien que centrale, reste souvent cantonnée à des rôles traditionnels (épouse, mère, séductrice punie…).
-
II. Une autocensure liée à des enjeux politiques et économiques
-
La peur des représailles politiques
-
La corruption, les abus de pouvoir ou les violences d’État sont peu représentés de manière directe.
-
Les rares films qui abordent ces questions le font souvent de façon métaphorique ou allégorique.
-
-
La dépendance aux financements privés et aux plateformes
-
Les producteurs évitent les sujets polémiques pour garantir la diffusion, notamment sur des plateformes comme Netflix, où les exigences commerciales favorisent des contenus « grand public ».
-
Cela pousse à une forme de neutralité éditoriale.
-
III. Des tentatives de rupture émergent malgré tout
-
Une nouvelle génération plus audacieuse
-
Certains jeunes réalisateurs, comme C.J. Obasi (Mami Wata, 2023) ou Akin Omotoso, commencent à aborder des thèmes marginaux ou à utiliser des codes esthétiques différents.
-
Des films comme Òlòtūré (2019) traitent de la traite des femmes, un sujet longtemps évité.
-
-
Le rôle des festivals internationaux et du streaming
-
Les festivals internationaux encouragent des récits plus audacieux.
-
Certaines plateformes soutiennent des projets expérimentaux ou engagés, ouvrant un espace pour ce que Nollywood taisait auparavant.
-
Conclusion
Nollywood, malgré son dynamisme et sa capacité à raconter le quotidien nigérian, reste marquée par de nombreuses zones d’ombre. Les tabous sociaux, les risques politiques et les impératifs commerciaux poussent souvent à une autocensure subtile mais puissante. Toutefois, une évolution est en cours. Portée par une nouvelle génération de cinéastes et l’ouverture à un public plus global, l’industrie commence timidement à explorer ce qu’elle taisait autrefois. L’avenir de Nollywood dépendra aussi de sa capacité à briser ces silences.
Suivez nous sur https://www.facebook.com/AfroBagTV